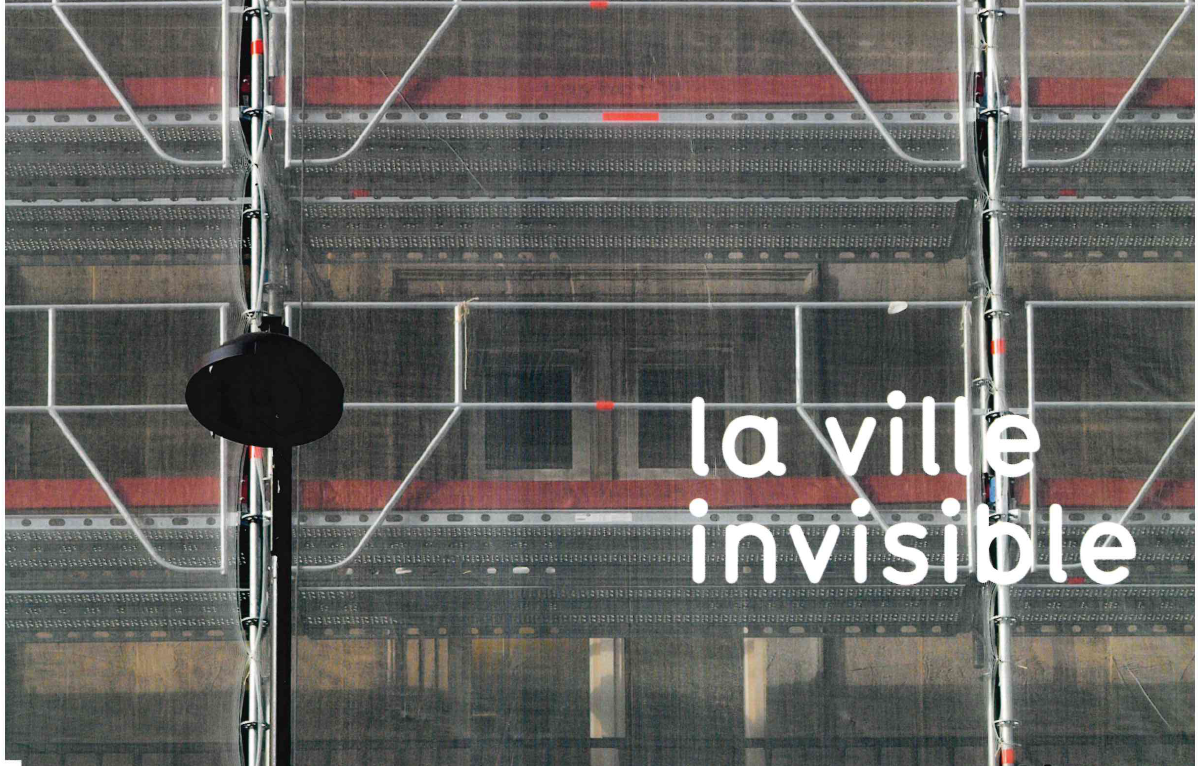L’habitat social est loin d’être reconnu unanimement comme objet patrimonial. Les divers regards qu’il a suscités depuis son apparition dans les années 1950 peuvent encore être discernés dans la cacophonie des débats actuels. De façon générale, il n’a pas bonne presse et une opinion commune semble le reléguer parmi les pires erreurs d’un passé proche.
Cependant des opinions minoritaires, professées par certains architectes et par une forte troupe de critiques et d’historiens de l’architecture, ont toujours milité en sens inverse, et la tendance semble être à notre époque de juger toute cette production avec un peu plus de sérénité et de curiosité. Pour rendre compte de ces regards si opposés il nous faut d’abord retranscrire l’histoire de la descente aux enfers des grands ensembles. Un second chapitre traitera des nouveaux regards portés sur eux et décrira les voies et les moyens d’une intervention critique et raisonnée permettant de sauvegarder ce qui peut et doit l’être.
Le déni des grands ensembles
La longue critique de l’habitat social
Le sommet de la popularité des grands ensembles semble avoir été atteint vers 1958, lorsque le journal Elle, dans son numéro d’août 1958, célèbre Sarcelles comme « une ville unique en Europe, quelque chose de grand, de neuf, de hardi ». Mais la roche Tarpéienne est proche du Capitole et, dès 1961, Christiane Rochefort décrit dans son roman Les Petits Enfants du siècle l’ennui profond généré par la “sarcellite” : « Le soir, les fenêtres s’allumaient et derrière il n’y avait que des familles heureuses, des familles heureuses, des familles heureuses. En passant, on pouvait voir sous les ampoules, à travers les larges baies, les bonheurs à la file, tous pareils comme des jumeaux, aucun cauchemar. Les bonheurs de la façade ouest pouvaient voir de chez eux les bonheurs de la façade est comme s’ils s’étaient regardés dans la glace. les bonheurs s’empilaient les uns sur les autres. »
On notera qu’il ne s’agissait pas d’une critique de l’incivilité ou de l’insécurité, mais seulement d’une critique poétique de l’uniformité. Ce n’était pas non plus l’hétérogénéité et encore moins la prolifération du différent qui étaient visées, mais au contraire la vertigineuse accumulation de l’identique dont les rangées uniformes de fenêtres donnaient une image frappante. C’est d’ailleurs cette critique-là qui sera la première à être reprise en compte par certains architectes, dont évidemment Émile Aillaud, dont le projet des Courtillières à Pantin, datant de la fin des années 1950, donnera dès le début des années 1960 une image célèbre et qui fera longtemps référence.
Dans les années 1960 les réponses des architectes à la critique de l’uniformité seront variées. Aillaud continuera ses recherches formelles fondées sur l’ondulation des formes (critique du chemin de grue), la dissolution des formes dans la couleur et la recherche de micro-ambiances urbaines, comme à Chanteloup-les-Vignes. D’autres tableront sur la variété des matériaux (Bossard). D’autres, enfin, restés fidèles au parallélépipède, le recouvriront de trames d’une grande élégance comme chez Dubuisson, pour dissoudre jusqu’à l’idée de percements répétitifs. Cependant ces réponses pouvaient être taxées d’épidermiques et ne satisfaisaient pas un rejet croissant du collectif, de la machine à habiter, un peu abusivement référé à l’exemple de Le Corbusier.
Vers 1968, l’idée s’impose de rétablir l’individu sinon même l’individualisme. Sa traduction administrative sera d’abord simpliste : revenir à la maison individuelle, comme on le verra à Villagexpo et, surtout, dans la production des chalandonnettes. Cette réponse n’était guère adaptée à l’esprit collectif qui continuait à animer la maîtrise d’ouvrage soutenue par un appareil productif industrialisé, qui avait rompu avec l’artisanat et la petite entreprise. La réaction sera donc le “proliférant” ou comment réintroduire des usages privatifs dans une production de masse industrialisée.
Dans la lignée d’Expo 67 et des constructions de Moshe Safdie à Montréal, toute une phalange d’architectes essaiera de combiner l’habitat individuel et la forme collective en développant une architecture en nappe censée retrouver la rue et la ville. D’abord développées avec modestie, mais non sans talent, dans les pyramides d’Andrault et Parat, les tentatives se développent chez Georges Candilis (Le Mirail) et Jean Renaudie, Renée Gailhoustet et d’autres, en véritables nappes urbaines d’une extrême sophistication. En vérité c’est l’exact opposé des tours et barres des années 1950 auxquelles avait mis fin une circulaire de 1973.
La production proliférante a été le courant le plus marquant des années 1970 et 1980; elle a été fortement encouragée par la pointe éclairée de l’appareil d’État, en particulier le Plan-Construction lancé en 1971. C’était l’époque où l’État non seulement ciblait sur l’habitat social des crédits considérables, mais où il était possible, voire recommandé, de s’affranchir de toute une série de réglementations. Les réalisations expérimentales (REX) du Plan-Construction ont soutenu l’innovation architecturale : à côté de Renaudie déjà cité, notons, par exemple, les réalisations de Kalouguine à Angers, où la végétation investissait une architecture qui semblait issue de Gaudi.
Cette évolution n’avait été possible que par une véritable révolution administrative, qui n’était rien moins que la suspension des normes (suspension sous observation et bilan critique). Un abîme sépare cette époque de la nôtre, où nous révérons les normes les plus arbitraires, les plus contradictoires et les plus sottes !
Cette histoire très schématique de l’habitat social durant les Trente Glorieuses essaie de démontrer que la dimension critique, la tentative presque forcenée de nouvelles formes architecturales ont été quasiment consubstantielles à toute cette histoire. Les images stéréotypées des tours et barres, des HLM sans âme, ne rendant absolument pas compte de la diversité et de la complexité d’une production qui, pour être réhabilitée (dans tous les sens du terme), doit d’abord être mieux connue.
L’unité de cette période se fonde sur la centralisation générale de tous les processus. Centralisation administrative par la technique des modèles : les REX eux-mêmes sont conçus comme des modèles, choisis à Paris, et dont on organise la diffusion sur le terrain. Centralisation de la commande, des financements, de la maîtrise d’ouvrage (quelques gros opérateurs HLM), de la fabrication (quelques grosses entreprises) et centralisation même du débat intellectuel qui est censé en être le moteur. Cette centralisation exprimait d’ailleurs le consensus profond entre les deux forces politiques majeures de l’époque: la technocratie gaulliste, férue d’équipement et de modernisation, et le PCF, soucieux de satisfaire et de contrôler sa clientèle. Or, vers 1975, ces deux piliers du temple s’effondrent. Les technocrates gaullistes sont remplacés par des équipes giscardiennes plus sensibles au vent du large libéral tandis que le PCF, atteint au cœur par le discrédit qui s’attache au marxisme et au communisme, entame sa descente aux enfers. Tout d’un coup les grands ensembles perdent leur meilleur soutien. La réforme Barre de 1975, qui visait à remplacer l’aide à la pierre par l’aide à la personne, censée être réalisée à financements constants, fut l’occasion plus que la cause du délabrement assez rapide du système, ce fut la fin du logement social soutenu à bout de bras par l’État.
Et ceci au moment même où son image dans l’opinion était plus calamiteuse que jamais. La critique de Christiane Rochefort était plutôt de nature intellectuelle. Par la suite, le soutien même de l’opinion progressiste et de gauche vint à manquer ; Jean Ferrat déplorait combien « la campagne était belle » et qu’il faille « dans mon HLM / bouffer du poulet aux hormones » ; Renaud, un peu plus tard, s’exclamera « Putain ! c’qu’il est blême / mon HLM ». Lorsque le soutien populaire vient à manquer à l’habitat populaire, ce dernier a du souci à se faire.
Architecture criminogène et architecte bouc émissaire
Le moment est venu de regrouper en un seul faisceau l’ensemble des critiques portées depuis presque le début de cette histoire -et jusqu’à maintenant- contre l’habitat social de masse. Un mot peut les résumer : criminogène. L’habitat social de masse est criminogène : il est responsable du malheur des cités, de la désespérance de ses habitants, des dérives qui s’y constatent ; les bandes, le racket, les trafics en tous genres, l’insécurité, tout cela est dû à cette architecture inhumaine, mal pensée, mal construite, sans lieux identifiables, où la promiscuité remplace la proximité, où les relations de voisinage sont supplantées par la défiance et l’intimidation, où le trafic de drogue se substitue aux échanges de bons procédés. Cette architecture tout à la fois insignifiante et arrogante engendre le malheur de ses habitants : tel est le propos, décelable dès le début et toujours inscrit au plus profond de l’inconscient des médias et des donneurs de bons conseils.
Lors de mes premières missions d’inspection, à partir de 2004, la violence des propos des hauts responsables territoriaux m’a surpris. L’un d’eux -pourtant responsable du logement- ne craignait pas d’assener « Moi, Monsieur, l’Architecture, je m’en fous! » Un autre de rang encore plus élevé essayait d’éveiller en moi la conscience des barrières de classe : « Mais enfin Monsieur l’inspecteur, on voit bien que vous n’y habitez pas. est-ce que vous accepteriez d’y habiter, etc. » Et puisque l’architecture était responsable, il ne pouvait y avoir qu’un seul coupable : l’architecte. L’architecte, voilà l’ennemi, ce “pelé”, ce “galeux”, d’où venait tout le mal…
Ce thème de l’architecte bouc émissaire vient de trop loin pour ne pas s’y attarder un peu. Dans le Dictionnaire des idées reçues, Flaubert parlait déjà de l’architecte distrait qui « oublie de construire l’escalier ». Au XXe siècle, cela ne s’arrange pas, l’architecte français ayant de plus en plus tendance à se replier sur la phase de conception, déléguant aux ingénieurs et bureaux d’études le souci des réalités matérielles. Et les architectes, du moins certains d’entre eux, ne seront pas les derniers, lors de la grande débâcle idéologique des grands ensembles, à battre leur coulpe, à se déclarer victimes de leur propre démesure et à s’accuser d’avoir voulu faire du “sublime”. Certains des grands prix nationaux de l’architecture s’exprimant dans le numéro édité en 2007 par le ministère de la Culture sur ce sujet, ne s’en privaient pas.
Les formes architecturales n’ont rien à voir avec le désespoir ou la délinquance de ceux qui y habitent. Nombre d’habitants de “barres” s’y sentent très bien et ne les lâcheraient pour rien au monde. On peut citer non seulement les habitants actuels de l’Unité d’habitation de Le Corbusier à Marseille, mais aussi ceux de Sarcelles, en dépit de leur extraordinaire diversité ethnique. Les bâtiments de Sarcelles, construits à R +4 en belle pierre de taille -celle du calcaire de Montmorency, utilisé également au château d’Écouen tout proche- ont très bien vieilli le long du grand mail arboré des citadins qui jouent aux boules ou devisent sur des bancs. La “sarcellite” n’est qu’un souvenir. Quant au proliférant savant critiqué pour ses fuites d’eau, ses ponts thermiques, ses circulations labyrinthiques, les constats s’avèrent très différenciés selon les lieux. Lors de notre mission sur l’îlot I de Renaudie à Villetaneuse, nous avons été amenés à visiter toutes les réalisations de Renaudie en France. S’il n’y a quasiment aucun problème à Ivry, à Givors les problèmes sont sous contrôle, en revanche, à Saint-Martin-d’Hères, il existe une vraie paupérisation et une vraie dégradation de l’habitat. Quant à Villetaneuse, la dégradation y a été la plus rapide (soit dix ans seulement après la livraison) et la plus sensible ! Il y a une grande variété de destins pour des formes architecturales très similaires. À l’inverse, l’actualité ne cesse de nous rappeler qu’il y a bien des problèmes derrière des façades et des formes architecturales habituellement référées à des bonheurs bourgeois ou petit-bourgeois. Combien d’immeubles à loyer, bien antérieurs aux grands ensembles, sont en fait livrés aux marchands de sommeil et constituent ce que l’on appelle “l’habitat indigne”. Un incendie meurtrier, il y à quelques années, a dévasté un banal immeuble parisien de l’avenue Vincent-Auriol à Paris et a jeté à la rue nombre d’immigrés. Ce n’était pourtant pas l’architecture haussmannienne de cet immeuble qui était en cause. C’était à l’origine un brave immeuble parisien, identique à des milliers d’autres qui continuent de fonctionner à la grande satisfaction de leurs habitants. Il n’y a pas de malédiction architecturale. En revanche, la malédiction touche certaines populations qui n’ont pas la maîtrise de leur destin et qui sont gérées en vase clos. À Ivry ou à Givors, les propositions de Renaudie fonctionnent car le maître d’ouvrage, très lié aux municipalités, a veillé, par l’intermédiaire des commissions d’attribution des logements, à tenir compte des désirs des individus et de leurs capacités financières. Il a veillé au maintien d’une certaine mixité. Il a aussi veillé à la permanence de l’entretien. Il s’est senti responsable de ces expériences, cependant parfois exceptionnelles, comme on peut se sentir attaché au fils prodigue, celui qui cause bien des soucis mais qui a du caractère et de qui l’on attend beaucoup. Une maîtrise d’ouvrage qui tend à disparaître, remplacée par des commerciaux bardés des diplômes de gestion les plus ronflants. En revanche, là où les gestionnaires de parcs sociaux n’ont mis en place aucune politique de population, c’est la relégation qui est arrivée ; la démission des locataires a embrayé sur celle des propriétaires et a abouti au ghetto. L’habitat social se dégrade dans la mesure exacte où il est géré en vase clos, en dehors des enracinements territoriaux qui fondent la démocratie et que, dans ce vase clos sont venues se faire piéger comme dans une nasse des populations captives. Beaucoup de grands ensembles sont hors marché, hors territoire et, finalement, hors démocratie. Il ne sert à rien d’y voter, car il n’y a pas d’habitat de rechange, et un bulletin de vote ne saurait sanctionner les vrais responsables. La malédiction des grands ensembles n’est pas à chercher dans leur forme, mais dans leur mode de gestion.
Démolition et dénaturation des grands ensembles
S’étant focalisées sur une explication principalement formelle, les réponses de la politique de la ville seront elles aussi purement formelles et s’attaqueront à la forme architecturale pour la dénaturer de toutes les façons possibles. La première de ces réponses est la peine de mort, c’est-à-dire la démolition. Cette solution a tout pour plaire. Vécue comme un rite collectif d’exorcisme et de purgation, elle est célébrée en grande pompe avant d’être retransmise au journal télévisé du soir dont elle satisfait le sens du spectaculaire ; il est cependant certain qu’à la joie de commande se mêle beaucoup de nostalgie de la part des principaux intéressés, qui perdent brutalement et sans retour un pan de leur propre histoire.
En 1974, le journaliste Peter Blake fit paraître son livre-pamphlet : L’architecture moderne est morte à Saint-Louis, Missouri, le 25 juillet 1972 à 15h32 (ou à peu près), qui montre en couverture le dynamitage de la barre du quartier de Pruitt-Igoe. Cet ouvrage alerte et partial, toujours agréable à lire, est l’un des premiers témoignages du thème de la démolition, les États-Unis ayant précédé la France d’une dizaine d’années dans la pratique et la théorie. Le thème de la démolition ne devait plus quitter le débat et fut même vigoureusement relancé avec l’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) au début des années 2000.
La démolition est une solution facile qui ne devrait guère être avancée que dans le cas d’insignifiance architecturale doublée d’une réelle décrépitude de l’état du bâti. Depuis plusieurs décennies, la construction de logements sociaux est notoirement insuffisante, et il apparaît contradictoire de continuer à démolir à grands frais des logements qui sont souvent en bon état. Les financiers rappellent qu’au bout de trente ans, durée théorique prévue pour leur obsolescence, ces logements sont financièrement amortis et techniquement en bout de course. Mais ce n’est précisément qu’une vue financière des choses : dans le logement social comme dans la construction, beaucoup d’immeubles sont encore viables après trente ans et c’est justement parce qu’ils sont encore là après leur amortissement qu’ils représentent un actif net, disponible sans autres frais que ceux de l’entretien. La destruction systématique de logements est une aberration non seulement au regard des besoins collectifs, mais aussi sur le plan économique puisqu’elle se prive de biens disponibles sans nouveaux investissements. Ce raisonnement économique global, valable dans une économie qui tiendrait compte du collectif et du durable, est battu en brèche par les logiques actuelles des bilans comptables, sectoriels et à court terme.
La démolition coûte cher. D’abord humainement et socialement, puisque les individus perdent une part de leur histoire intime et familiale. Qui s’en soucie, puisque le bonheur n’est pas encore pris en compte dans les bilans ! La démolition coûte également cher, non seulement financièrement, mais surtout parce qu’elle allonge les délais des réalisations et oblige à de complexes opérations tiroirs. Enfin, elle est écologiquement contre-productive, nécessitant des norias de camions dont le bilan carbone est oublié. Et elle pèse doublement sur la nature car la construction neuve, généralement en béton, oblige à des prélèvements dans le lit des rivières ou le sable des estuaires, dont l’impact est de plus en plus agressif. Ensuite, les matériaux issus de la démolition sont de plus en plus difficilement utilisables: la filière de recyclage du béton de démolition n’est pas encore au point, et les chantiers autoroutiers où de lignes de TGV pour l’utiliser en ballast ne sont pas éternels. En conséquence, le bilan écologique de la démolition n’est pas neutre.
Cependant, aucun coût collectif n’étant pour le moment pris en compte, la démolition a encore de beaux jours devant elle. Au début des années 2000, elle a représenté l’une des caractéristiques essentielles des opérations de requalification urbaine subventionnées par l’ANRU. La démolition a été financée à un point tel que le nombre de logements à démolir devenait une des conditions de l’équilibre financier de l’opération : plus on démolirait, plus on recevrait de subventions ; l’effet pervers de cette procédure était encore accru par l’absence totale de prise en compte des qualités architecturales et urbaines du bâti concerné. Il a d’ailleurs fallu au ministère de la Culture, alerté par des architectes et historiens passionnés, une longue ténacité pour réintroduire un regard architectural dans l’instruction des dossiers ANRU.
Si la pratique de la démolition n’est pas condamnable et peut être envisagée dans le cadre de projets architecturaux et urbains affirmés intégrant la préoccupation mémorielle, en revanche l’idéologie de la démolition est pernicieuse et contre-productive. L’idéologie du “on-va-tout-détruire-et-on-va-reconstruire-une-ville-humaine” ressemble étrangement à celle-là même qui avait cours dans les années 1950-1960 et qui avait précisément donné naissance aux grands ensembles. Il s’agit bien dans les deux cas de la même idée de la tabula rasa et du même fantasme selon lequel on peut fabriquer une forme parfaite. En stigmatisant sans nuances la forme grand ensemble, on ne fait que reprendre le raisonnement qui les a rendus possibles. Vertige de la rationalité à la française. Illusion de la toute-puissance d’une décision despotique et éclairée. Fantasme de la création absolue.
Pour lire la suite de l’article, cliquer ici
Francis CHASSEL
Inspecteur général honoraire, ministère de la Culture