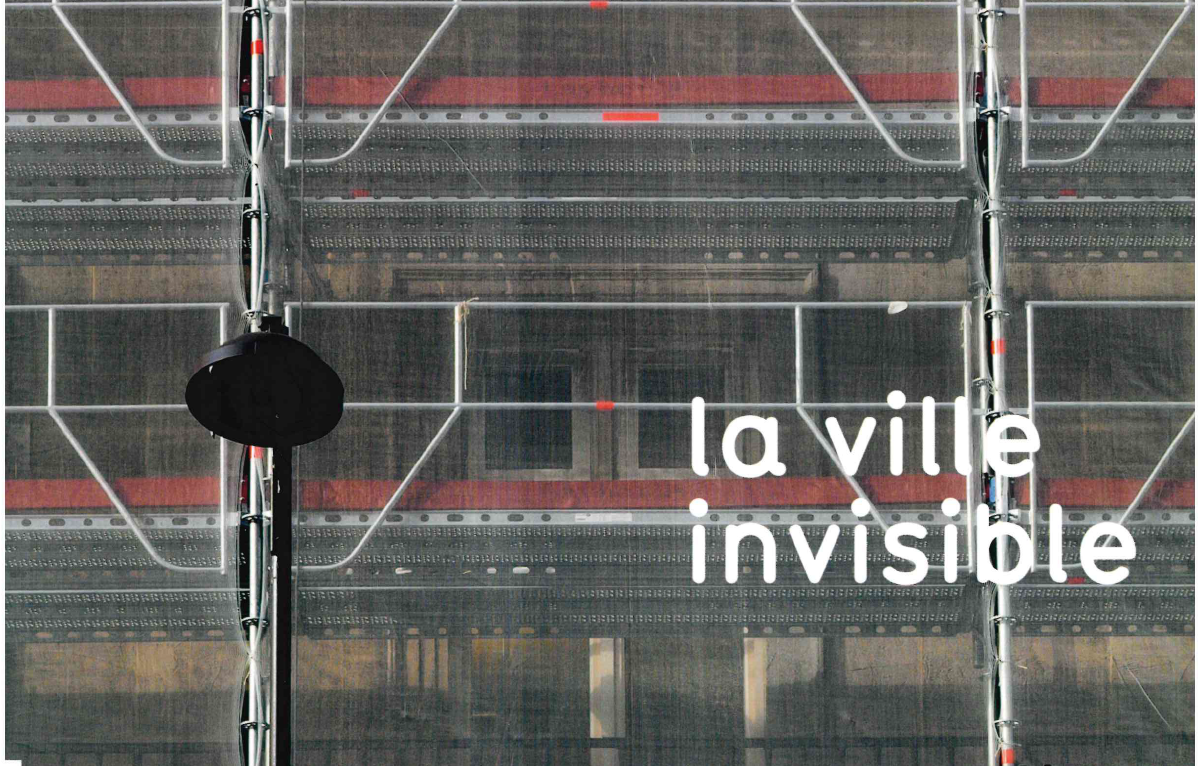L’habitat social est loin d’être reconnu unanimement comme objet patrimonial. Les divers regards qu’il a suscités depuis son apparition dans les années 1950 peuvent encore être discernés dans la cacophonie des débats actuels. De façon générale, il n’a pas bonne presse et une opinion commune semble le reléguer parmi les pires erreurs d’un passé proche.
Pour lire le début de l’article, cliquer ici
Les dénaturations brouillonnes
À côté de la forme absolue du déni qu’est la démolition, se constate toute une série de raisonnements partiels induisant des interventions brouillonnes dont le résultat final est une dénaturation profonde de la forme et de l’esprit des grands ensembles. Ces interventions se conjuguent d’ailleurs toujours avec des démolitions partielles. L’analyse de trois de ces thèmes que l’on retrouve peu ou prou dans la plupart des dossiers de rénovation urbaine est édifante : la décoration en façade, le désenclavement, le retour à une typologie d’habitat individuel.
Le relookage (nous employons volontairement cet affreux vocable) des façades a été fort à la mode dans les années 1980 et a trouvé son support opérationnel dans les primes à l’amélioration des logements à usage locatif et d’occupation sociale (Palulos), créées en 1977. L’idée principale était de lutter contre le sentiment d’uniformité donné par les façades répétitives dont on casse l’image par des bardages variés et multicolores les transformant en tapisseries multicolores, ou mieux (ou pis) encore en substituant à l’image de la barre uniforme celle d’une succession de villas folkloriques régionalistes ou médiévalisantes. Divers ajouts de type décoratif tels de faux frontons ou des porches saillants tentaient de mettre en scène l’illusion d’un retour à la ville traditionnelle. Ces bariolages épidermiques étaient aussi l’occasion de procéder à des ravalements que l’on n’avait pas réalisés depuis vingt ans, ainsi que des isolations par l’extérieur que la crise de l’énergie commençait à rendre nécessaires. Certains architectes auteurs des réalisations originelles ont parfois même, faute de pouvoir s’y opposer, prêté la main à ces ajouts en tentant d’en minorer l’effet. C’est ainsi qu’Émile Aillaud, à la fin de sa vie, a signé les revêtements en bardage des tours tribodes de la cité des Courtillières à Pantin. Ce n’est pas sa meilleure intervention, mais on doit quand même noter qu’elle a été faite avec soin et sans remettre en cause l’appréhension de la forme globale. Tel n’est pas le cas de la plupart des Palulos. Le résultat global est celui d’une cacophonie stridente d’effets de couleurs et de matériaux, bien différente de la naturelle, je dirais presque biologique, diversité de la ville ancienne, sans réussir évidemment à masquer la planéité réelle du bâti primitif. C’est pourquoi une variante sophistiquée a vite été inventée. Elle consiste à tendre devant l’ancienne façade une nouvelle façade plus ou moins pleine, intégrant balcons, loggias, extensions de surfaces et même nouvelles circulations. L’idée d’une nouvelle façade intégrant de nouvelles prestations n’est pas critiquable en soi. Ce qui l’est, c’est son systématisme, ainsi que sa réalisation souvent à l’économie (financement oblige). L’effet est souvent celui d’un fragile échafaudage dressé devant l’ancienne façade encore bien perceptible. Au total, les relookages des années 1980 apparaissent comme une solution peu sérieuse, une phase infantile de la politique de rénovation urbaine.
À partir des années 1990 se développe la pratique des trouées et des ouvertures par lesquelles les démolitions partielles prétendent concourir au désenclavement des cités. On ne lutte pas contre l’uniformité, mais contre l’isolement des grands ensembles. On veut les ouvrir sur l’extérieur, sur un autre pôle urbain existant ou à créer. On veut rompre le sentiment d’enfermement et créer dans la cité des mouvements centrifuges. C’est un raisonnement qui donne bonne conscience et auquel aucun élu de bonne foi ne saurait résister. Hélas, il ne s’agit le plus souvent que d’un raisonnement assez platement sécuritaire visant à casser l’image de la “citadelle ouvrière” et à faciliter l’intervention rapide et groupée des forces de l’ordre. Alors chef du SDAP de Paris, j’en eus une bonne illustration lors des travaux entrepris au début des années 1990 sur la cité Bonnier, exceptionnel ensemble HLM des années 1920 construit par Henri Bonnier, architecte voyer de la ville de Paris, au 140, rue de Ménilmontant. Outre la démolition de quelques îlots d’immeubles, le projet se singularisait par la démolition d’une partie du bâti pour donner une sortie arrière à la cité. Sensible aux impératifs de sécurité, je proposai, plutôt qu’une démolition, un haut porche donnant aux forces de police l’issue souhaitée et sauvegardant l’intégralité du skyline médiéval de cette cité. La démolition fut préférée car elle avait l’avantage psychologique et symbolique de casser l’image de la citadelle ouvrière. Je subodore que l’avantage sécuritaire est souvent plus symbolique que réel, car toute ouverture créée peut fonctionner dans les deux sens, et les fuyards s’échapper comme les forces de sécurité entrer. J’ai d’ailleurs pu constater que les techniciens de la sécurité étaient plus réservés que les politiques sur les solutions d’ouverture, mais ce n’était pas eux qui décidaient. Si la sécurité, incontestable demande sociale, doit bien être prise en compte dans les stratégies de rénovation du bâti, il ne faut pas être dupe de son instrumentalisation possible à des fins qui ne sont plus vraiment urbanistiques.
Après les bariolages cosmétiques, puis les démolitions sécuritaires, viennent enfin les tentatives de retour à l’habitat individuel. Beaucoup de projets ANRU présentent actuellement l’insertion, à travers la trame ancienne plus ou moins conservée des grands blocs caractéristiques, d’une micro-trame de petits collectifs et de petit habitat individuel en bande, éventuellement dotés de petits jardins privatifs réactualisant ainsi l’abbé Lemire et sa Ligue française du coin de terre et du foyer de la fin du XIXe siècle. Je me garderai pourtant de critiquer a priori toutes ces initiatives. Il est hors de doute, en effet, que les grands ensembles ne souffrent pas d’un excès, mais d’un déficit de densité. Les espaces verts abusivement présentés à l’origine comme nature, mais non vécus comme tels, sont effectivement, au sein des cités, une réserve pour de nouveaux équipements, de nouvelles constructions, de nouveaux usages, pour peu qu’on veuille bien y investir de la réflexion, y compris avec les habitants. Et même la privatisation, sous forme de jardins ouvriers nouvelle manière, y est envisageable si elle doit bénéficier à tous. En revanche, glisser du pseudo où du quasi-pavillonnaire dans la trame des grands ensembles élargie par quelques démolitions paraît une démarche sans issue, sinon même dangereuse. Telle est pourtant l’impression que donnent encore nombre de projets ANRU qui présentent des petites lignes ondulantes de quasi-pavillonnaires enserrées ou encagées dans ce qui reste de la sévère trame d’origine. Il faut admettre une densification et de nouvelles constructions pensées dans l’esprit et la continuation de la trame d’origine dont elles offriraient comme une modulation sur le mode mineur, mais non un brouillage des typologies urbaines.
Une visite à Chanteloup-les-Vignes
Pour se rendre compte des dégâts, malheureusement irréversibles, causés à une réalisation exemplaire des années 1960 par une série d’interventions brouillonnes et sans réflexion, il faut se rendre à Chanteloup-les-Vignes, d’Émile Aillaud. Celui qui se souviendrait de la réception enthousiaste de cette œuvre en son temps, ou qui aurait encore devant les yeux le témoignage éblouissant du livre paru chez Fayard en 1978 risque un infarctus, un coup de sang ou un coup de colère, au choix.
Permanentes depuis la fin des années 1970, les interventions conjuguent, avec une belle allégresse, une rare constance à s’acharner sur cette œuvre, à la défigurer, ainsi qu’une volonté sans faille d’en rendre impossible toute lisibilité. La composition d’Aillaud se caractérisait par une série de petites ambiances urbaines reliées par des articulations très subtiles et unifiées par une vision artistique s’exprimant par un traitement de sol sophistiqué, des œuvres d’art poétiques et des pignons monumentaux dus à Fabio Rieti célébrant Nerval, Baudelaire, Hugo, Rimbaud et Valéry. Tout ce travail est saccagé. Plusieurs de ces pièces urbaines ont été purement et simplement détruites, le traitement de sol en pierres appareillées constituant en lui-même une œuvre d’art a été remplacé par un nouveau nivellement totalement banal et macadamisé. Les œuvres d’art non entretenues émergent encore, mais font pitié au milieu de leur nouvel environnement. L’hippopotame semble vivre les derniers spasmes d’une espèce condamnée. L’un des portraits de poêtes a disparu avec le bâtiment qui en était le support et les quatre autres pignons sont défigurés par d’obscènes adjonctions : faux frontons triangulaires juchés en équilibre instable au-dessus des pignons cubiques et dont une vue latérale fait apparaître les tirants destinés à les maintenir et, surtout, faux pilastres classiques préfabriqués, scotchés sur les compositions de Rieti et encadrant le visage de Rimbaud… À la place de l’acrotère filant uniformément sur tous les bâtiments prolifère maintenant toute une gamme de faux pignons, faux frontons issus du délire décoratif post-moderne que les politiques de Palulos avaient favorisé dans les années 1980.
Toutes les gammes de l’outrage semblent avoir été essayées en cumulant leurs effets : destruction de la forme urbaine, effacement du traitement de sol, travestissement caricatural des œuvres d’art. Comment expliquer un tel acharnement ?
Chanteloup-les-Vignes peut être considéré comme un musée des erreurs, des tics, des modes et des faux-semblants de la politique des quartiers sensibles depuis trente ans. La seule politique menée avec constance, c’est la volonté de défigurer le lieu. Si seulement de ce désastre pouvait émerger une promesse, un espoir d’un nouveau quartier de ville ! En fait, la forme urbaine d’Aillaud brisée, celle qui s’élabore sous nos yeux est chaotique, sans idée-force, sans aménité. Les quelques traces d’Aillaud encore repérables apparaissent comme flottant à la dérive, incompréhensibles et, pour le coup, vaines et inutiles. Aujourd’hui la critique avancée par certains à l’époque, mais alors non fondée, de la vacuité de ces figures de poètes égarés dans un non-lieu, devient réalité.
Oui, par respect pour Aillaud et son souvenir, il vaudrait mieux qu’il ne reste rien à Chanteloup-les-Vignes de son œuvre ; il vaudrait mieux effacer le blasphème et, pour une fois, tout reprendre à la base.
La redécouverte de l’habitat social
Cette redécouverte passe par de nouveaux regards : celui de l’histoire économique et sociale, celui de l’historien de l’architecture et de la ville, celui de l’institution culturelle et, enfin, celui la culture architecturale réinjectée dans le projet de réhabilitation.
Le regard de l’histoire sociale et économique
La saga du logement social marque une grande page de l’histoire de France dont il n’y a pas lieu de rougir et il fut un temps où ce logement était associé au bonheur. En 1945, la France avait été largement dévastée par deux guerres mondiales et les reconstructions d’après 1918 et de Vichy étaient bien loin d’avoir rétabli le stock. D’autant que la politique du blocage des loyers avait totalement asséché l’initiative privée. À partir des années 1950, la politique de modernisation agricole chassait de leurs exploitations une masse croissante de petits fermiers et de journaliers agricoles. Enfin, à partir de 1957-1958, et massivement à partir de 1962, des millions de Français rapatriés des colonies et ayant en général tout perdu, se présentaient sans moyens sur un marché du logement totalement débordé. Sans compter une relance massive de l’immigration étrangère organisée par le patronat dès les années 1950 pour pallier le déficit de main-d’œuvre (et aussi pour peser sur les salaires). La situation catastrophique, potentiellement explosive, requérait une intervention urgente et massive de l’État. Ce dernier fut à la hauteur et, pendant trente ans, l’augmentation annuelle des logements livrés fut l’un des indicateurs les plus sacrés de l‘“ardente obligation” planificatrice. Il a fallu combler en trente ans un immense retard. Une des pages les plus glorieuses de toute l’histoire économique française et la meilleure contribution à la paix sociale retrouvée se sont ainsi écrites sur le terrain.
Les nouveaux logements ont été au début reçus avec enthousiasme. Comment en aurait il été autrement pour ces millions de gens qui n’avaient jamais connu que l’absence de point d’eau ou de toilettes, la cohabitation forcée de plusieurs générations, la privation de tout confort et même, pour beaucoup d’entre eux, le sol en terre battue, la cahute, la zone, le gourbi, le bidonville. L’HLM a été un progrès, mieux une libération, une accession à la dignité de l’être humain. Le bonheur d’y vivre est attesté par tous les témoignages et toutes les enquêtes rétrospectives. D’autant que la mixité y était à l’époque bien réelle, comme le rappelle Gérard Monnier. Au début des années 1960, les Courtillières à Pantin se présentaient comme un habitat plutôt petit-bourgeois, pacifié, et où fonctionnaient parfaitement les dispositifs spatiaux inventés en rez-de-chaussée par Émile Aillaud, à savoir les lieux de bricolage mi-publics mi-privés, ouverts sur l’extérieur et sur le parc central, en fait de vrais lieux de convivialité. Les petits employés en quête d’un logement décent, les victimes de l’exode rural ou les premiers rescapés de la débâcle coloniale s’y retrouvaient en bonne harmonie, communiant dans l’espérance d’un progrès promis et déjà largement constatable. Le pari semblait tenu. La mémoire de ce bonheur initial doit être mentionnée car elle démontre que ces lieux n’ont pas été créés pour être des lieux de malheur et de désespérance. Ils ont été des lieux de promotion sociale et ne sont devenus lieux de relégation que parce que l’intendance n’a pas suivi et a été remplacée par une gestion à courte vue. Ils peuvent redevenir ce qu’ils furent si tous le veulent.
Le regard de l’historien de l’architecture et de la ville
Dans son plaidoyer pour le logement social, l’historien de l’architecture et de la ville peut tenir deux discours complémentaires. Le premier discours -le discours positif- est de montrer la place éminente du logement social dans l’histoire de l’architecture. Le second discours, plutôt tenu par des historiens de la ville, et que j’appellerai discours a contrario, est de montrer que la disgrâce actuelle de l’habitat social n’est pas un cas isolé ou unique et que d’autres configurations urbaines sont elles aussi passées par une phase infamante avant d’être triomphalement réhabilitées devant le tribunal de l’opinion.
Le logement social, de 1950 à 1980, a été le laboratoire et le lieu d’excellence de l’architecture française. Certes, il ne résume pas à lui tout seul toute l’architecture. Il y eut des artistes indépendants : Chaneac, Bruyère, par exemple. Il y eut dans le domaine des loisirs des réalisations remarquables à la Grande-Motte où à Avoriaz. Il y eut le dernier Le Corbusier ou Claude Parent. C’est dans le logement social qu’ont eu lieu les grandes recherches (et trouvailles) sur la cellule logement -alors que l’habitat bourgeois restait désespérément standardisé-, ainsi que les grandes recherches du type pyramides ou proliférant qui essayaient d’embrasser en un même geste l’architecture et la ville. Ce moment historique a été celui d’une folle inventivité ; Honegger, Aillaud, Candilis et Renaudie ont mis le meilleur d’eux-mêmes dans l’habitat social dont ils formulent les propositions les plus variées. Les historiens de l’architecture comme G. Monnier où J. Lucan l’ont bien montré, et cette production fut fort admirée à l’étranger, comme en attestent les pèlerinages internationaux aux Courtillières ou le salut adressé par Bruno Zevi à Renaudie.
Il y a un esprit de cette période qui est celui d’une expérimentation parfois intrépide et même déchaînée. Qui est aussi celui d’une commande d’État : ce fut à mon sens le dernier chapitre d’une histoire bien française et qui remonte à l’Ancien Régime, celle de l’architecte du Prince, directement branché sur la commande publique. Le chapitre qui s’ouvre après 1974 (disons après le concours de la Roquette qui vit émerger Christian de Portzamparc) sera celui de l’architecture urbaine fondée sur les études historiques de typo-morphologie à l’italienne. Ce sera aussi, après la décentralisation en 1982, une explosion de la commande auprès de nouveaux acteurs locaux. Ce sera, enfin, une période où la créativité aura quitté le logement social pour investir les musées, les médiathèques et finalement les sièges sociaux des grandes entreprises internationales.
Entre 1950 et 1980, un chapitre bien particulier de l’histoire de l’architecture française, énorme en quantité de mètres carrés produits et tout à fait impressionnant en termes de réalisations remarquables, à l’inverse des périodes qui l’ont précédé et suivi, se sera concentré sur un seul produit : l’habitat social, et accroché à un acteur principal : l’État.
C’est ce chapitre bien particulier de l’histoire de l’architecture qui doit être revisité et dont il importe, comme pour toutes les grandes époques, de garder les témoignages les plus significatifs. Cette production a un immense intérêt, soit, et c’est une raison pour ne pas tirer un trait dessus. Il en est également une autre : d’autres formes architecturales et urbaines avaient, en leur temps, fait l’objet de critiques tout aussi vives que la postérité n’a pas confirmées.
À l’époque de la création, en 1907, du fichier sanitaire et de la définition des premiers îlots insalubres, il paraissait évident que certains quartiers historiques en centre-ville devaient être démolis. La maladie, la pauvreté, la crasse, la vétusté, tout condamnait ces îlots et les démolitions souhaitées par l’ensemble des édiles, architectes, urbanistes et hygiénistes, commençaient à se réaliser. Or une génération après, changement complet de décor, les mêmes quartiers deviennent le nec plus ultra de la civilisation urbaine. Aux opérations de démolition succèdent les opérations de restauration. Les bourgeois éclairés, l’avant-garde de l’élite et des prescripteurs de mode chassent les pauvres. De stigmatisés, ces mêmes quartiers redeviennent désirés. Du statut juridique d’îlots à détruire, ils deviennent secteurs sauvegardés. Qui se souvient que jusque vers 1970, le vieux quartier Galande-Montebello, face à Notre-Dame, était voué à la démolition ? Il fut sauvé grâce aux amoureux des vieilles pierres, et aujourd’hui (fin 2010), le mètre carré s’y vend quinze mille euros.
Les causes de cette mutation rapide et spectaculaire sont complexes. Elles tiennent sans doute à une nouvelle manière de penser l’hygiène sociale et la politique urbaine. Ainsi, dans un passé pas si lointain une forme architecturale et urbaine totalement stigmatisée a été sauvegardée. Les leçons de l’histoire doivent nous amener à réfléchir sur les prétendus consensus et les prétendues évidences.
Le regard institutionnel : la longue histoire de la patrimonialisation
La protection monument historique
Parmi les institutions d’État à l’origine lointaine du ministère de la Culture, celle des Monuments historiques est la plus ancienne. Spécifiquement créée en 1831 pour protéger un patrimoine médiéval fort menacé depuis la vente des biens nationaux, elle eut longtemps cette particularité doctrinale. La protection monuments historiques s’élargit ensuite à l’architecture classique, puis vers 1960 à l’art1900, vers 1970 à l’architecture du XXe siècle en tant que telle, vers 1980 à l’architecture industrielle, puis à des patrimoines thématiques : balnéaire, maritime, etc. Rien ne s’opposait donc, en théorie, à ce que le patrimoine du logement social fût progressivement concerné par la demande de protection. Chaque fois qu’un patrimoine bâti émerge du rejet, c’est le ministre de la Culture que l’on interpelle, comme on le vit après 2004, notamment dans le cas des logements de Jean Renaudie à Villetaneuse ou à la cité des Courtillières d’Émile Aillaud, à Pantin. Mais le bilan de la protection MH appliquée au logement social est actuellement (en 2011) des plus maigres.
Les cités radieuses de Le Corbusier, d’abord Marseille, puis progressivement l’ensemble des autres cités, Briey, Nantes, Firminy, ont été protégées. Cependant, elles ont une histoire particulière, qui n’est pas exactement celle du logement social, mais plutôt celle de la commande d’exception, confiée à un architecte prestigieux, et c’est comme telles qu’elles sont entrées dans la grande famille des monuments historiques. La cité de la Muette construite dans les années 1930 à Drancy par Beaudoin et Lods, après destruction des tours en 1976, fut protégée pendant les années 2000 comme lieu de mémoire de la déportation des Juifs de France, mais aussi comme remarquable réalisation architecturale de son temps. Françoise Choay avait d’ailleurs à l’époque relevé les apories d’une telle protection et il est de fait que, pour utile qu’elle ait été, la protection fut difficile à mettre en œuvre et les travaux, menés sous maîtrise MH, ne purent empêcher une large utilisation de fenêtres en PVC en lieu et place des menuiseries métalliques d’origine. La protection MH fut accordée à la tour Perret, à Amiens, dans le même esprit grand œuvre dont avait bénéficié Le Corbusier puis, dans les années 1990, à la tour Croulebarbe construite par Édouard Albert à Paris. Les protections ne furent pas inutiles, non pas pour éviter une destruction qui ne fut jamais réellement envisagée mais pour garantir, grâce à l’intervention de spécialistes et à la procédure de débats en commission, un traitement architectural digne de la réputation de l’œuvre et de l’auteur -notamment, pour Albert, sauvegarder cette délicate structure métallique que l’on ne pourrait plus construire aujourd’hui. Quant à la protection MH accordée à la Grand’Mare à Rouen (Beaudoin et Lods), elle apparaît comme un unicum. Finalement, il a fallu attendre 2010 pour que le ministère de la Culture, sans doute effrayé de sa propre audace, prenne une instance de protection concernant la cité de l’Étoile construite en 1955 par Georges Candilis, à Bobigny, pour le compte de l’abbé Pierre et de la société Emmaüs. Première réalisation après le célèbre appel de 1954, la cité, quoique construite en urgence, ne fut pas une cité “d’urgence” et Candilis y mit beaucoup de soin. Cette valeur historique et architecturale ne fut pas reconnue par les responsables actuels d’Emmaüs, on peut le déplorer, mais le cas n’est pas rare de propriétaires peu soucieux de la valeur historique de leur bien et c’est ce qui légitime une instance de protection prononcée par les pouvoirs publics. Il n’est pas certain qu’au bout d’un an, cette instance se dénoue par une protection définitive, mais ce délai aura au moins permis de mettre en place une procédure de débat contradictoire enrichissant le projet dans un sens patrimonial.
Les diverses applications ci-dessus décrites de la loi du 31 décembre 1913 ne touchent le logement social que marginalement. Soit il ne s’agit guère de logement social stricto sensu : cas de Perret, de Le Corbusier ou d’Albert, soit la protection MH est en fait commandée par un motif extérieur autrement plus puissant que la qualité architecturale, comme ce fut le cas à Drancy. En fait c’est seulement en 2010 que dans le cas de la cité de l’Étoile à Bobigny, le ministère de la Culture s’attaqua frontalement au problème de la protection d’un habitat social menacé sous la forme d’une instance de classement.
Pour lire la suite de l’article, cliquer ici
Francis CHASSEL
Inspecteur général honoraire, ministère de la Culture